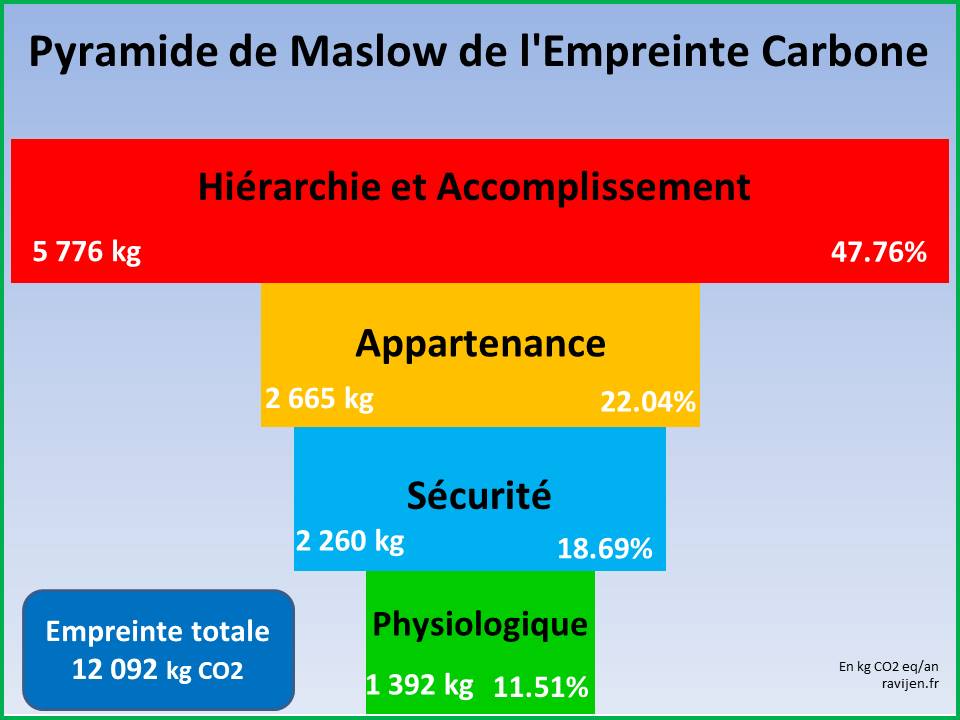Un article intitulé la décarbonation est-elle vraiment possible ? est accompagné d’une vidéo de Jean-Marc Jancovici. Quelques points marquants de cette vidéo méritent d’être relevés et discutés.
Cette conférence est organisée par EDF dans le cadre d’un cycle de conférences intitulé “ECO2” qui vise à “animer le débat intellectuel sur la notion de croissance verte autour de laquelle aucun consensus scientifique n’existe à ce jour”. Plutôt qu’une conférence, c’est en fait un jeu de questions-réponses animé par Frédérique Bedos, journaliste et fondatrice de l’ONG d’information “le projet Imagine”. Les invités sont Thomas-Olivier Léautier - chef économiste d’EDF - qui participe à toutes les conférences du cycle “ECO2” (car c’est EDF qui finance ce cycle de conférences) et Jean-Marc Jancovici - fondateur de Carbone 4 - oracle et cassandre du changement climatique.
La conférence donne l’impression que Thomas-Olivier Léautier et Jean-Marc Jancovici ne parlent pas de la même chose. Quand le premier parle d’un horizon à 6 mois, ou d’un futur technologique imaginaire, le second apporte des faits, des projections chiffrées et précises. C’est comme si les deux discours, qui ne parlent pas de la même chose et qui parfois s’oppose, étaient juxtaposés sans que jamais l’intervieweuse ne fasse apparaître les incohérences, les oppositions et les conséquences qui en découlent.
Evidemment, comme Thomas-Olivier Léautier est “chez lui”, il n’est pas challengé lors de cette conférence, la conférence reste dans le domaine du politiquement correct. Par ailleurs, malgré les oppositions des discours, Thomas-Olivier Léautier est probablement heureux d’être confronté à Jean-marc Jancovici car ce dernier estime que le nucléaire fait partie de la solution d’un futur mix-énergétique. Il ne faut pour autant pas résumer le propos de Jean-Marc Jancovici à sa position sur le nucléaire. Il aurait été appréciable que le reste de son positionnement puisse être opposé aux propos parfois fantaisistes ou déconnectés de la réalité de Thomas-Olivier Léautier.
- 1h01 - les limites des facteurs de substitution d’énergie
Il faut 50 à 100 fois plus de métal et 1000 fois plus de foncier pour faire un kWh d’énergie solaire que pour faire 1 kWh d’énergie classique (charbon, gaz, nucléaire)
- 1h03 - comment la démocratie peut organiser sa réduction du PIB
La récession structurelle a déjà commencée depuis 2006 (selon Jean-Marc Jancovici) ou en 2008 (selon l’AIE), date du pic de production du pétrole conventionnel. La quantité de pétrole disponible pour les européens à commencé à décroitre en 2007. Depuis, l’augmentation du PIB représente de l’inflation d’actif (un même bien coûte plus cher qu’avant, c’est de la simple inflation, mais pas une augmentation de la richesse réelle). C’est de la fausse croissance. Il n’est donc pas besoin de vendre la décroissance aux Français car elle est en réalité déjà là. En outre, la décroissance ne pose problème aux ménages que si les revenus baissent mais que les charges ne baissent pas. Si les deux baissent de manière coordonnée, la décroissance est tout à fait gérable au niveau des ménages.
- 1h10 - le système doit pouvoir s’ajuster à la baisse comme à la hausse
Et aujourd’hui, le système ne sait pas gérer la baisse. Le problème n’est donc pas au niveau individuel, ou d’un ménage, mais à un niveau plus global, systémique.
- 1h14 - langue de bois de EDF, parole de vérité de Jancovici
Thomas-Olivier Léautier ne veut pas aller vers la décroissance. Le chef économiste d’EDF se masque alors les yeux (littéralement, avec son masque) quand Jean-Marc Jancovici explique qu’on n’échappera pas à la décroissance, malgré le volontarisme affiché de Thomas-Olivier Léantier. Cette anecdote rigolote est la note humoristique symbolique de la conférence.
- 1h15 - il est nécessaire d’avoir des plans pour l’avenir qui ne présupposent pas que le PIB augmente
Jean-Marc Jancovici indique qu’on peut garder le PIB comme indicateur économique, à la condition de ne plus exiger qu’il augmente indéfiniment…
En conclusion, cette conférence laisse une impression mitigée dans un exercice où deux personnes exposent chacune leur point de vue plutôt que de débattre et de confronter leurs idées. Olivier-Thomas Léautier semble optimiste et dogmatique, Jean-Marc Jancovici semble pessimiste et réaliste.