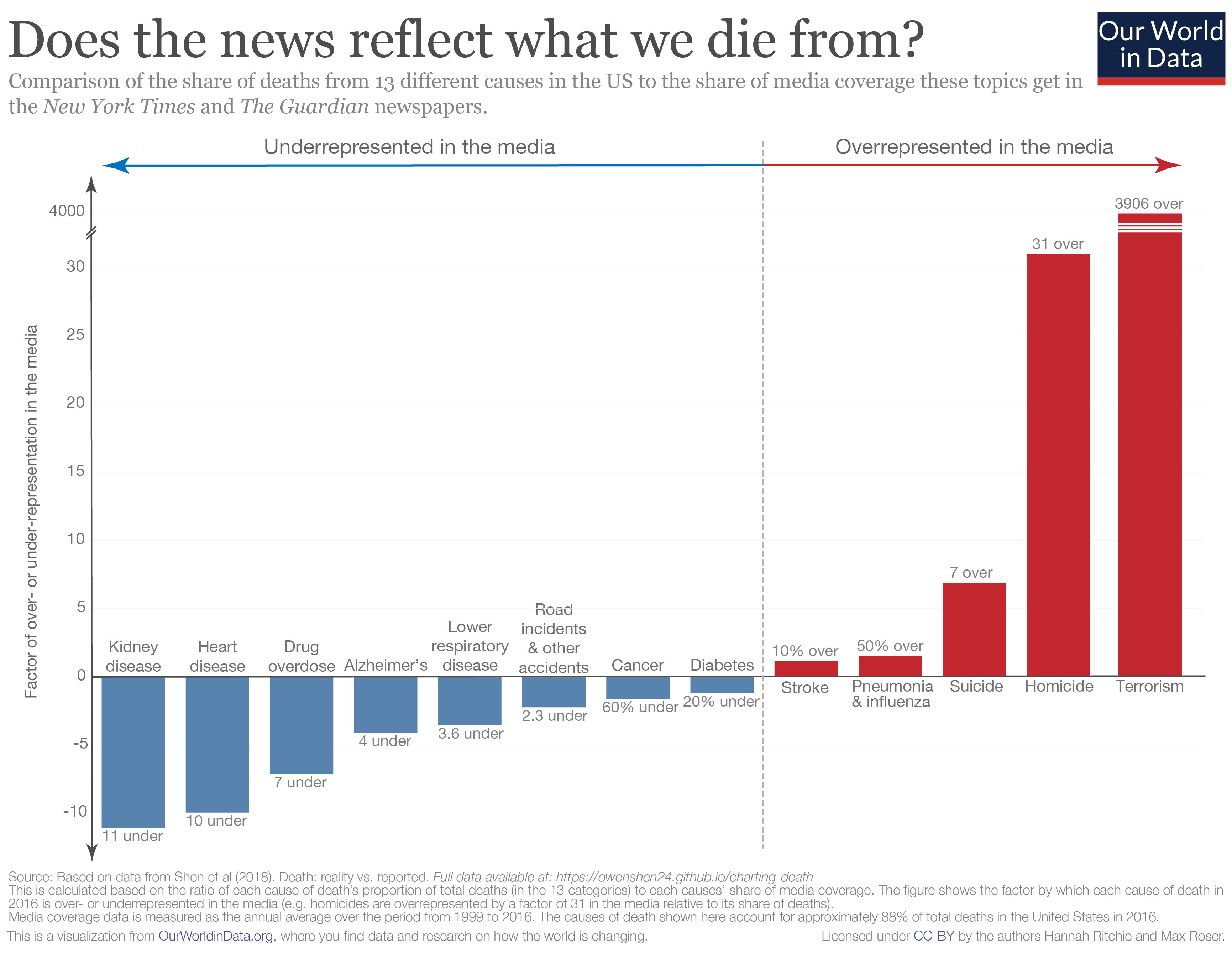Dans un article intitulé les gilets jaunes et la question démocratique, l’auteur explique comment le mouvement des gilets jaunes remet en cause les fondements même du régime représentatif français. Samuel Hayat est l’auteur d’une thèse intitulée au nom du peuple français, la représentation politique en question autour de la révolution de 1848 en France.
Selon son analyse, une revendication des gilets jaunes serait de décider eux-mêmes, sans avoir à élire un représentant ou un porte-parole.
Aujourd’hui, c’est cette vieille question de la démocratie qui revient : pourquoi, au fond, faudrait-il que ce soit toujours les mêmes qui décident, ces professionnels de la politique, au langage en bois, aux jeux obscurs et au mépris du peuple affiché ? Pourquoi donc le peuple ne pourrait-il pas faire ses affaires lui-même, de temps à autre, au moins pour les choses importantes ?
Même si le mouvement des gilets jaunes est récent, l’aspiration à l’autodétermination n’est pas nouvelle.
Il ne s’agit pas là d’une simple inconstance des médias et des politicien.ne.s. Si le RIC s’est imposé si aisément et si le conflit autour de lui a pris des proportions si grandes, c’est que cette polémique touche à quelque chose de fondamental. Elle est révélatrice d’un affrontement, présent de manière plus ou moins ouverte depuis le début du mouvement, mais qui a ses racines dans une histoire bien plus longue, entre deux conceptions de la politique.
Les deux conceptions de la politique sont la politique partisane :
[…] la politique partisane, est centrée sur la compétition électorale entre professionnel.le.s du champ politique pour accéder au pouvoir. Elle fonctionne par la production de visions du monde antagonistes (des idéologies), objectivées dans des programmes entre lesquels les citoyens sont sommé.e.s de choisir, sous peine de se condamner à l’invisibilité politique.
et la politique citoyenniste :
Mais le mouvement des Gilets jaunes, en particulier depuis que le RIC est devenu son cheval de bataille, a mis sur le devant de la scène une autre conception de la politique, que l’on peut qualifier de citoyenniste. Elle repose sur la revendication d’une déprofessionnalisation de la politique, au profit d’une participation directe des citoyens, visant à faire régner l’opinion authentique du peuple, sans médiation.
Cette politique citoyenniste est centrée sur les citoyens et sur les idées plutôt que sur les partis.
La conception citoyenniste de la politique, par son refus principiel des schémas de la politique partisane, n’est pas seulement ouverte à la « récupération », terme clé de la politique des partis : elle cherche à être reprise, diffusée, réappropriée, par qui que ce soit. En cela, elle est bien plus ouverte que la politique partisane, elle n’a pas de coût d’entrée, pas de langage spécifique à manier, pas de jeu à saisir – elle est, disons le mot, éminemment démocratique.
Alors que la république française a opté pour un régime aristocratique ou oligarchique, c’est le rêve d’une démocratie réelle qui anime les gilets jaunes.
C’est cette question que le pouvoir n’arrive même pas à entendre : le mouvement des Gilets jaunes puise sa force dans la revendication démocratique. Alors que la politique professionnelle s’appuie sur la monopolisation du pouvoir par un petit groupe, une oligarchie, la politique citoyenniste entend, par le référendum, donner le pouvoir à n’importe qui, c’est-à-dire à tout le monde à égalité. C’est le sens qu’avaient les termes démocratie et aristocratie en Grèce antique, et qu’ils ont gardé jusqu’au XVIIIe siècle : la démocratie, c’est le règne du peuple agissant directement, ou bien par des citoyens tirés au sort ; l’élection, quant à elle, est la procédure aristocratique par excellence, elle donne le pouvoir à une élite. Or le triomphe du gouvernement représentatif et de ses institutions, en premier lieu l’élection, s’est fait sur le refoulement de cette possibilité politique, sur l’oubli de ce que la démocratie pouvait vouloir dire, oubli renforcé par la récupération, pour qualifier le gouvernement représentatif, du vocabulaire de la démocratie. La politique démocratique s’est trouvée ainsi escamotée au profit d’une forme aristocratique de gouvernement, rebaptisée progressivement « démocratie représentative ». C’est pour cela qu’en temps normal, cette conception citoyenniste de la politique, refoulée, est peu audible – mais elle n’a jamais entièrement disparu. L’aspiration démocratique refait régulièrement surface, en 1848, en 1871, en 1936, en 1968, en 2018, chaque fois qu’a lieu un mouvement de contestation générale des gouvernants et de leur jeu, au nom du peuple. Et chaque fois, les cadres d’analyse manquent aux professionnel.le.s pour comprendre ce qui a lieu, eux qui vivent par et pour le refoulement de ces aspirations démocratiques. Le mouvement des Gilets jaunes donne donc à voir une possibilité claire : déprofessionnaliser la politique, aller vers un règne des citoyen.ne.s, au nom de l’idéal qui forme désormais le sens commun du plus grand nombre, la démocratie.
Face à ce mouvement citoyenniste, qui ira défendre la vieille politique, celle des partis et des élu.e.s ? A part ceux qui sont payés pour, gageons qu’il y aura peu de monde. C’est que la politique partisane se trouve déjà fortement affaiblie, et ce de longue date. D’abord, le conflit partisan s’est émoussé : vu du dehors du monde des professionnel.le.s, il n’y a plus, depuis longtemps, de différence significative entre la droite et la gauche, qu’il s’agisse de l’origine sociale des candidat.e.s ou de la nature des politiques menées. Partout, avec quelques nuances indéchiffrables pour le plus grand nombre, on trouve la même marchandisation des services publics, les mêmes manœuvres de séduction adressées aux capitalistes pour attirer leurs précieux investissements, le même zèle à limiter les libertés publiques, surarmer les forces de l’ordre, enfermer les pauvres et expulser les étranger.e.s.
La politique partisane s’est sabordée elle-même en brouillant les frontière entre les partis, entre la droite et la gauche. L’absence d’alternative au néolibéralisme constitue une impasse qui démontre l’inutilité de cette politique.
Les tenants mêmes du pouvoir, les professionnel.le.s de la politique, semblent ne plus croire aux possibilités de l’action politique, et répètent avec diverses modulations qu’il n’y a pas d’alternative au néolibéralisme. Pourquoi alors défendre leur jeu, si de leur propre aveu, il n’a plus d’enjeu ?
Et cette absence d’alternative au néolibéralisme vise à instituer une forme d’ordolibéralisme où le champ des possibles d’un gouvernement est restreint par des lois que l’état s’impose à lui-même.
[…] la politique citoyenniste puise sa force dans le mécontentement justifié vis-à-vis de la politique partisane et dans une longue histoire de l’aspiration démocratique, mais aussi dans la montée en puissance des cadres de pensée du gouvernement des expert.e.s, de tous ceux qui veulent remplacer la politique (politics) par une série de mesures techniques (policies), néolibéraux en tête.
Selon l’auteur, la démocratie c’est le dissensus. La troisième voie qu’il propose entre la politique partisane et la politique citoyenniste consiste à déprofessionnaliser la politique, démocratiser le dissensus et à faire entrer les masses en politique.
Face à cette opposition entre une conception partisane professionnalisée et une conception citoyenniste consensuelle de la politique, une autre voie existe, même si les moyens de l’arpenter restent incertains. Il s’agit de chercher à déprofessionnaliser la politique sans en éliminer le caractère conflictuel, c’est-à-dire de démocratiser le dissensus. C’est ce qu’ont essayé de faire, en 1848, les défenseurs de la République démocratique et sociale : faire entrer les masses en politique, non pour les faire voter sur telle ou telle mesure, mais pour réaliser une politique de classe, le socialisme, dans l’intérêt des prolétaires et contre la bourgeoisie. Il s’agissait alors de donner une visibilité aux clivages sociaux, et non de les dissimuler derrière tel dispositif participatif, aussi démocratique fût-il.
Peut-être pourrait on s’inspirer du projet des défenseurs de la république démocratique et sociale de 1848 ?