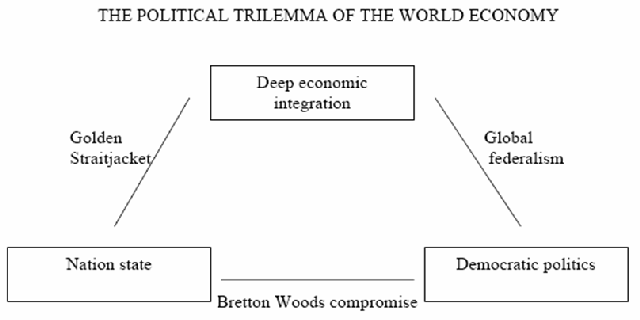Benjamin Bayart est l’auteur de la conférence intitulée Internet libre, ou Minitel 2.0 ? au cours de laquelle il explique l’importance de défendre, protéger et promouvoir la caractéristique décentralisée d’internet.
Faisant suite à cette conférence, un “entretien numérique” intitulé il est désormais possible de relocaliser le monde lui donne l’occasion de revenir sur des sujets importants liés à internet mais qui dépassent la problématique technique d’internet pour s’intéresser aux effets qu’il peut induire sur la société.
En fait, il ne s’agit pas de comprendre le réseau, mais la société qui vient. Et parmi ces fondamentaux, il y a d’abord la nécessité de comprendre la modification du tissus social. C’est assez facile à expliquer. Posons qu’une société se définit par les interactions entre les gens : le média structure la société. Il n’y a là rien de neuf. C’est-à-dire qu’il y a eu la société de l’écriture manuscrite, puis la société que l’imprimerie a formé – qui est l’un des facteur-clés dans le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Il y a ensuite la société que la télévision a formé, qui est encore différente. Et enfin, il y a Internet, qui change beaucoup plus profondément les choses que la télévision.
Ces évolutions techniques portent des modèles profonds. L’imprimerie, c’est un éditeur qui juge que l’écrit est suffisamment important pour être publié et qui le diffuse vers des lecteurs n’ayant pas eu leur mot à dire dans cette décision. C’est un monde vertical. Alors qu’avec Internet, tout le monde publie, et lit qui veut bien lire. Le modèle – je parle bien du réseau, pas de services à la Google ou Facebook – est ainsi totalement horizontal.
Il aborde ensuite le sujet de la propriété intellectuelle, qui a bien occupé nos politiciens et la scène médiatique ces dernières années avec les lois à répétition qui concourent à filtrer internet à le recentraliser.
Bien sûr que non. Parce qu’une idée ne peut pas être à vous. Si vous étiez né dans une grotte d’ermite, abandonné par vos parents et élevé par des loups, et qu’il vous vienne une idée géniale, on pourrait légitimement supposer qu’elle est un peu à vous ; elle serait à 90 % aux loups, mais un peu à vous. La véritable quantité d’innovation dans une œuvre de l’esprit est toujours marginale. À preuve, si une œuvre de l’esprit est trop innovante, elle devient incompréhensible : si vous inventez la langue dans laquelle votre texte est écrit, il ne sera jamais lu.
La très grande majorité d’une œuvre appartient donc de facto à la société. L’apport de l’auteur est extrêmement faible – ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas de valeur. C’est l’une des raisons pour laquelle, dans les débats sur le droit d’auteur au début du XIXe, un grand principe s’est imposé, celui du domaine public. Par principe, toute œuvre appartient au domaine public ; par exception et pendant un temps donné, une exclusivité est accordée à l’auteur. C’était alors une exception de très courte durée ; de mémoire, ce devait être neuf ans renouvelables une fois. Aujourd’hui, cette durée est devenue délirante : on parle de rémunérer les petits-enfants pour le travail effectué par le grand-père…
Enfin, la problématique de la décentralisation peut très bien trouver sa solution dans l’auto-hébergement de ressources informatiques et réseaux.
Il en va de même en ce qui concerne les serveurs. Si vous avez chez vous un petit bout de serveur qui correspond parfaitement à la puissance dont vous avez besoin (soit moins de puissance qu’un iPhone pour la majorité des gens, c’est-à-dire une quantité d’énergie très limitée) : parfait. Pas besoin d’alimenter des bandes passantes énormes vers des serveurs qui sont à l’autre bout de la planète, stockés par centaines de milliers dans un data-center de 30 000 mètres carrés qu’il faut refroidir en permanence – pour peu que ce soit dans les déserts de Californie, il faut les climatiser… L’efficacité énergétique est bien meilleure quand le réseau est décentralisé, il est même possible de l’alimenter avec un petit peu de photovoltaïque. Essayez un petit peu d’alimenter un data-center avec du photovoltaïque, on va doucement rigoler…
Pour résumer : tel qu’il existe aujourd’hui, le coût énergétique du réseau est négligeable par rapport aux gains qu’il permet ; mais il est très important par rapport à ce qu’il pourrait être. Par contre, le coût énergétique des machines de Google – qui ne participe pas du réseau, mais des services – est tout simplement énorme. Vous saviez que Google, qui doit faire tourner peu ou prou dix millions de machines, était le deuxième ou troisième plus gros fabricant d’ordinateur au monde ? Juste pour ses propres besoins… C’est du délire.
L’avenir nous dira si nous avons su tirer partie d’internet comme un levier de progrès social, ou comme un facteur de régression sociale.